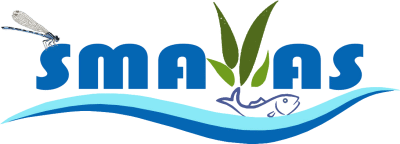A
Fosse profonde creusée dans le lit par l'action de l'eau.
Modification de l'état d'un milieu aquatique ou d'un hydrosystème, allant dans le sens d'une dégradation. Les altérations se définissent par leur nature (physique, organique, toxique, bactériologique,...) et leurs effets (eutrophisation, asphyxie, empoisonnement, modification des peuplements,...). Le plus souvent ces altérations sont anthropiques mais peuvent aussi être d'origine naturelle.
L’amont désigne la partie d’un cours d’eau qui, par rapport à un point donné, se situe entre ce point et sa source.
Ensemble des zones humides en relation permanente ou temporaire avec le milieu courant par des connections soit superficielles soit souterraines : iscles, îles, brotteaux, lônes, bras morts, prairies inondables, forêts inondables, ripisylves, sources et rivières phréatiques....
Fait par l’homme, dû à sa présence et à son existence.
Ensemble des processus biologiques (dégradation, consommation de la matière organique, photosynthèse, respiration animale et végétale...), chimiques (oxydoréduction...), physiques (dilution, dispersion, adsorption...) permettant à un écosystème aquatique équilibré de transformer ou d'éliminer les substances (essentiellement organiques) qui lui sont apportées (pollution). On doit distinguer l'autoépuration vraie (élimination de la pollution) de l'autoépuration apparente (transformation, transfert dans l'espace ou dans le temps de la pollution). Les organismes vivants (bactéries, champignons, algues...) jouent un rôle essentiel dans ce processus. L'efficacité augmente avec la température et le temps de séjour. La capacité d'autoépuration d'un écosystème est limitée et peut être inhibée (toxique notamment).
Un organisme autotrophe est capable de synthétiser par lui-même les matières organiques qui le composent à partir d'éléments minéraux. C'est le cas de la plupart des plantes chlorophylliennes.
B
Ouvrage artificiel barrant le lit d’un cours d’eau et servant soit à en assurer la régulation, soit à permettre l’alimentation en eau des villes, l’irrigation des cultures ou bien la production d’énergie (on parle alors de barrage hydroélectrique).
Il s'agit de l'ensemble des affluents et "sous-affluents" d'un cours d'eau. A chaque cours d'eau correspond un bassin versant. Bien entendu, selon l'échelle à laquelle on se place, il y a de petits et de grands bassins. Les plus grands étant ceux qui correspondent aux exutoires des grands fleuves.
Espace géographique dans lequel toutes les eaux de pluie ou de ruissellement s’écoulent dans la même direction et se rejoignent pour former un cours d’eau ou un lac.
La berge est formée par les terrains situés à droite et à gauche du cours d’eau et qui délimitent le lit mineur. Cet espace abrite des plantes et arbustes dont les racines limitent l’érosion et fournissent un ombrage et une alimentation nécessaires à la vie aquatique.
Ancien bras plus ou moins déconnecté du lit principal du fait du déplacement de celui-ci au fil des temps ou des mécanismes de sédimentation. Milieu caractéristique des lits majeurs en bordure des rivières à méandres et à tresses.
Mousses végétales aquatiques. Du fait de leur pouvoir bio-cumulateur de certaines substances (métaux), elles sont utilisées pour connaître la pollution qui a transité dans le milieu durant les 3 derniers mois. Elles accumulent parfaitement les métaux, les iodes.
C
Cours d’eau artificiel, construit par l’homme pour l’irrigation, l’énergie, le refroidissement, le transport ou l’alimentation en eau potable. Il est alimenté par prélèvement d’eau des cours d’eau ou des retenues.
Capacité biologique, chimique et physique permettant à un milieu de dégrader tout ou partie des substances présentes, notamment organiques. Ce phénomène est fortement lié à l'état fonctionnel dans lequel se trouve le milieu, mais aussi à la capacité d'autoélimination des impuretés par des organismes aquatiques vivants.
Dérivation d'une ressource en eau. Au sens restreint, désigne tout ouvrage utilisé couramment pour l'exploitation d'eaux de surface ou souterraines.
Chablis
Arbre ou ensemble d'arbres renversés, déracinés ou cassés (chandelles*, volis*) le plus souvent par suite d’un accident climatique (vent,neige, givre...).
Chandelle
Partie cassée d’un chablis, restant sur pied.
Point de rencontre de deux cours d’eau.
Propriété d'une eau à attaquer certains matériaux par une action chimique, physico-chimique ou biochimique.
L'existence d'un cours d'eau est juridiquement caractérisée par la permanence du lit, le caractère naturel du cours d'eau ou son affectation à l'écoulement normal des eaux (exemple : canal offrant à la rivière, dans un intérêt collectif, un débouché supplémentaire ou remplaçant le lit naturel) et une alimentation suffisante, ne se limitant pas à des rejets ou à des eaux de pluies (l'existence d'une source est nécessaire).
Cours d'eau qui ne sont pas classés comme appartenant au domaine public. Les propriétaires riverains, propriétaires de la moitié du lit, doivent en assurer l'entretien régulier.
Montée plus ou moins brutale du niveau d'un cours d'eau, liée à une croissance du débit jusqu'à un niveau maximum. Ce phénomène peut se traduire par un débordement du lit mineur*. Les crues font partie du régime d'un cours d'eau. En situation exceptionnelle, les débordements peuvent devenir dommageables par l'extension et la durée des inondations (en plaine) ou par la violence des courants (crues torrentielles). On caractérise aussi les crues par leur période de récurrence ou période de retour (voir récurrence).
Dans la nature, à des échelles de temps plus ou moins longues, l’eau circule suivant un cycle qui reproduit les phénomènes de vaporisation et de condensation. L’eau s’évapore des océans, forme les nuages, tombe sous forme de pluie ou autre, circule, s’infiltre et s’évapore de nouveau. C’est un mouvement perpétuel. C’est toujours la même eau qui circule, dans les mêmes quantités.
D
Seuil en dessous duquel sont mises en péril l’alimentation en eau potable et la survie des espèces présentes dans la rivière.
Valeur de débit maintenu à l'aval d'un ouvrage localisé de prise d'eau (rivière court-circuitée,...) en application de l'article L-232-5 du code rural (loi "Pêche"). Cet article vise explicitement les "ouvrages à construire dans le lit d'un cours d'eau", et les "dispositifs" à aménager pour maintenir un certain débit. Il oblige à laisser passer un débit minimal garantissant la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux. Ce débit minimal est au moins égal au dixième du module (au 1/40e pour les installations existantes au 29/06/84) ou au débit entrant si ce dernier est inférieur. Le débit minimal est souvent appelé, à tort, débit réservé.
Débit minimal éventuellement augmenté des prélèvements autorisés sur le tronçon influencé. Il est exprimé notamment dans les cahiers des charges et les règlements d'eau. Souvent utilisé à tort à la place de débit minimal.
E
Eau apportée aux sols ou aux supports de culture des plantes dans le but d'accroître leur humidité et de fournir l'eau nécessaire à la croissance normale des plantes et/ou d'éviter l'accumulation d'un excédent de sels dans le sol (voir irrigation).
Eau provenant des précipitations atmosphériques et qui ne s'est pas encore chargée de substances solubles provenant de la terre.
Partie des précipitations ou de l'eau de fusion nivale qui s'écoule rapidement à la surface du sol et des versants.
Eau souterraine qui émerge à la surface du sol.
Eau ayant une faible teneur en ions de calcium et magnésium. Eau qui renferme peu de sel ou pas du tout.
Eau ayant une teneur élevée en ions calcium et magnésium.
Eau dont les caractères n'ont pas été altérés par l'activité humaine.
Masse d'eau de surface au sein de laquelle il y a peu ou pas de courant et dans laquelle des changements de qualité défavorable peuvent survenir après une longue période de temps.
Volume d'eau lâché à partir d'un ouvrage hydraulique (ouverture d'une porte d'écluse, turbinage d'eau stockée dans un barrage réservoir...) et se traduisant par des variations de débits brusques et artificielles.
Embâcle
Accumulation de bois morts et déchets divers, cette accumulation est amenée par les courants. Il entrave plus ou moins le lit mineur du cours d'eau. L'écoulement peut en être perturbé, surtout en cas de crues.
L’érosion est une altération des sols par les agents atmosphériques, hydrologiques, ou par l'action de l'homme. Le travail du sol et la diminution du taux de matière organique sont des facteurs d’aggravation de l’érosion.
L’étiage est une période de l’année pendant laquelle le niveau d’eau des rivières, cours d’eau, est le plus bas.
Enrichissement d'une eau en sels minéraux (nitrates et phosphates, notamment), entraînant des déséquilibres écologiques tels que la prolifération de la végétation aquatique ou l'appauvrissement du milieu en oxygène. Ce processus, naturel, ou artificiel (dans ce cas, on parle aussi de dystrophisation), peut concerner les lacs, les étangs, certaines rivières et les eaux littorales peu profondes.
F
Cours d’eau qui aboutit à la mer. En général, il donne son nom au cours d’eau le plus long entre sa source et la mer (ou l’estuaire). Les autres qui l’alimentent sont des affluents.
Lieu ou les poissons pondent leurs œufs pour se reproduire.
G
Discipline qui étudie les formes de relief et leur mobilité, leur dynamique. Dans le cadre des hydrosystèmes, l'analyse porte sur la géométrie du lit des cours d'eau et les causes de ses transformations spatiales (de l'amont vers l'aval) ou temporelles en relation avec la modification des flux liquides et solides, la dynamique de la végétation riveraine, les interventions humaines. Il s'agit donc d'une science d'interface et de synthèse qui fait appel à des données naturalistes et expérimentales (hydraulique et hydrologie notamment) et à des données issues des sciences humaines (histoire, économie agricole...).
Différence de charge hydraulique entre deux points d’un aquifère par unité de distance, selon une direction donnée. Le gradient hydraulique est le moteur de l’écoulement des eaux souterraines. Celui s’effectue soit latéralement, des zones de recharge vers les zones de drainage, soit verticalement entre des niveaux aquifères superposés.
Excavation créée par l'exploitation de granulats dans la plaine alluviale d'un cours d'eau et plus ou moins alimentée en eau par la nappe alluviale. De même il pourra s'agir d'un ensemble d'excavation faisant partie d'une même exploitation. Au sens de la codification hydrographique, les gravières ne sont plus en exploitation 2 - plan d'eau d'origine artificielle créé par extraction de granulats et alimenté essentiellement par la nappe souterraine.
H
Qualifie toutes les activités relevant de la pêche sous toutes ses formes, professionnelle ou de loisirs, en eau douce ou marine.
Science qui étudie la vie des organismes aquatiques.
Étude de la morphologie des cours d'eau, notamment l'évolution des profils en long et en travers, et du tracé planimétrique : capture, méandres, anastomoses etc... L’hydromorphologie vise à définir la forme des bassins hydrographiques, la densité et l’organisation du drainage.
Ensemble des éléments d'eau courante, d'eau stagnante, semi-aquatiques, terrestres, tant superficiels que souterrains et leurs interactions. Ce concept s'applique surtout pour les cours d'eau d'une certaine importance susceptibles de développer une plaine alluviale comprenant une mosaïque d'éléments suffisamment grands pour assurer le développement de communautés vivantes différenciées.
Se dit des êtres vivants, plus particulièrement des végétaux , qui ont besoin de beaucoup d'humidité pour se développer.
I
Repose sur l’examen des peuplements d’invertébrés aquatiques peuplant le fond des rivières (larves d’insectes, mollusques, crustacés, vers, etc.). Une note de 0 à 20 est attribuée au niveau d'une station de mesure après étude de ce peuplement d'invertébrés. La valeur de cet indice dépend à la fois de la qualité du milieu physique (structure du fond, état des berges...) et de la qualité de l'eau.
Il permet d’évaluer la qualité écologique des cours d’eau du point de vue de leur peuplement piscicole. Le principe de cet indice est d’évaluer la différence entre la structure du peuplement de poissons échantillonné et celle d'un peuplement de référence attendu en l’absence de toute perturbation.
Pénétration de l’eau de pluie dans le sol par percolation. Elle renouvelle les stocks d'eau souterraine (on parle de recharge) et entretient le débit de l'écoulement souterrain dans les formations hydrogéologiques perméables du sous-sol. Par comparaison avec l'écoulement de surface, l'écoulement souterrain peut être lent, différé et de longue durée (quelques heures à plusieurs milliers d'années).
Apport d’eau sur un terrain cultivé pour compenser l’insuffisance de précipitations et permettre le bon développement des plantes. Dans le monde, les 2/3 de l’eau sont utilisés pour l’irrigation des cultures.
J
Plante aquatique, symbole de l’eutrophisation de l’eau.
Détermination des caractéristiques de l’écoulement (vitesse ou débit) pour un cours d’eau ou une source.